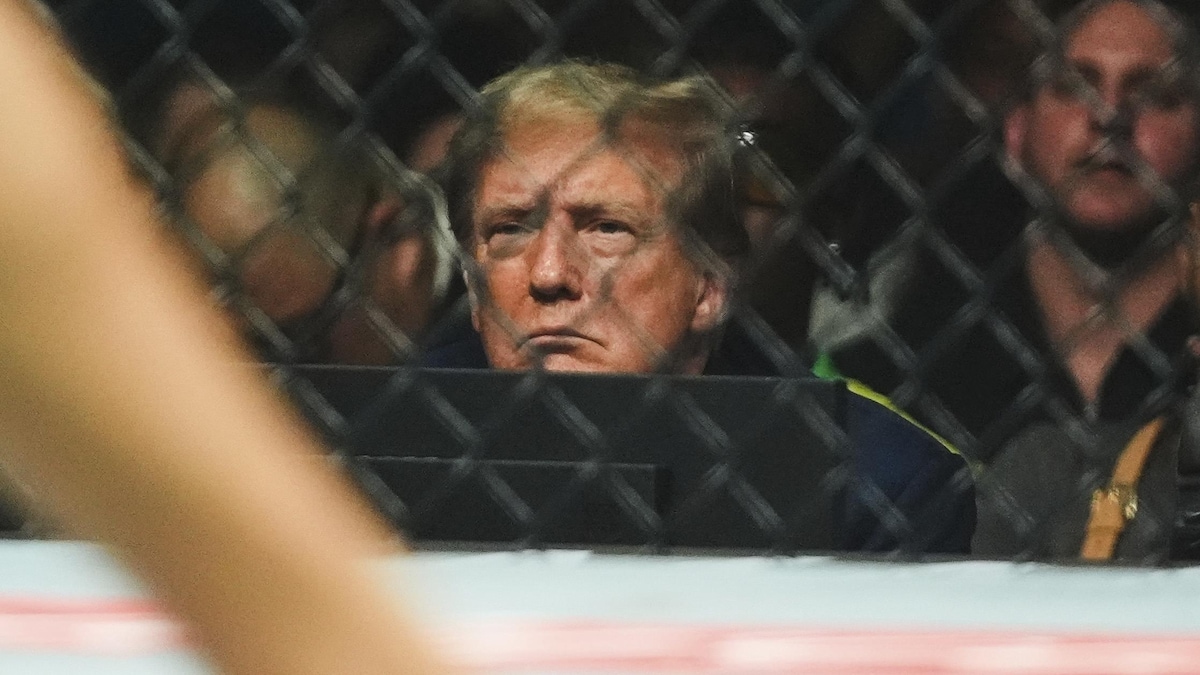La Cour d’appel du Québec valide la Loi sur la laïcité de l’État
Le tribunal donne raison sur toute la ligne au gouvernement de François Legault. Ou presque.

Le gouvernement de François Legault avait porté en appel la décision de la Cour supérieure du Québec.
Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers
C'est une importante victoire juridique pour le gouvernement Legault : la Cour d'appel du Québec a confirmé jeudi la constitutionnalité de la Loi sur la laïcité de l'État et a validé son application dans les commissions scolaires anglophones.
Après 15 mois de délibérations, le plus haut tribunal de la province a rendu son verdict dans un jugement de quelque 300 pages (Nouvelle fenêtre).
Les magistrats Manon Savard, Yves-Marie Morissette et Marie-France Bich ont non seulement validé la décision rendue en avril 2021 par la Cour supérieure, mais ont aussi conclu que la Loi sur la laïcité de l'État – mieux connue sous le nom de « loi 21 » – ne viole pas les droits linguistiques des commissions scolaires anglophones.
Autre nuance : le tribunal a donné raison au juge de première instance Marc-André Blanchard au sujet de l'exclusion des députés de l'Assemblée nationale de l'application de la loi.
En d'autres mots, la Cour d'appel a estimé que les élus devraient avoir le droit de porter des signes religieux, contrairement aux autres représentants de l'État en position d'autorité comme les juges, les procureurs de la Couronne, les gardiens de prison, les policiers, les directeurs d'école et les enseignants.
Le recours à la « clause nonobstant » validé
Adoptée en juin 2019, la « loi 21 », qui interdit à plusieurs catégories d'employés de l'État québécois de porter des signes religieux dans l'exercice de leurs fonctions, cause la polémique depuis bientôt cinq ans, tant au Québec que dans les autres provinces canadiennes. Ses opposants font notamment valoir qu'elle contrevient aux chartes canadienne et québécoise des droits et libertés.
- Ailleurs sur info Selon Trump, une peine de prison pourrait être un « point de rupture » pour ses partisans
- Ailleurs sur info Élections américaines : « L’inquiétude ne nous sert pas », dit l’ambassadrice du Canada
- Ailleurs sur info Félix Auger-Aliassime ne fait pas le poids face à Carlos Alcaraz à Paris
Pour soustraire sa loi à toute poursuite, le gouvernement Legault a invoqué de manière préventive la disposition de dérogation (aussi appelée « clause dérogatoire » ou « clause nonobstant ») de la Constitution, une utilisation validée par les juges Savard, Morissette et Bich.
La Cour n’est pas habilitée à statuer sur la question de savoir si la Loi porte atteinte aux libertés de religion et d’expression ou au droit à l’égalité que garantissent les chartes
, écrivent-ils.
L'invocation de la disposition de dérogation devant être renouvelée tous les cinq ans, le ministre Jean-François Roberge a déposé plus tôt ce mois-ci le projet de loi 52. Son adoption, probable, devrait permettre au gouvernement Legault de soustraire la « loi 21 » à toute contestation judiciaire pendant cinq années de plus.

Entrevue avec Louis-Philippe Lampron, professeur titulaire à la Faculté de droit de l'Université Laval et spécialiste en droit constitutionnel
Dans un court point de presse jeudi, le premier ministre du Québec, François Legault, a déclaré que la décision de la Cour d'appel constitue une belle victoire pour la nation québécoise
.
Le gouvernement du Québec va continuer d’utiliser la clause dérogatoire aussi longtemps qu'il va le falloir, pour que le Canada reconnaisse les choix de société de la nation québécoise. C’est non négociable.
Dans un même ordre d'idées, Simon Jolin-Barrette a affirmé sur les ondes d'ICI RDI que ce n'était pas nécessairement une évidence
que cette affaire se rende en Cour suprême.
Pour nous, le dossier est somme toute clos. C'est une victoire sur toute la ligne. On vient de reconnaître la souveraineté du Parlement du Québec
, s'est réjoui le ministre de la Justice du Québec.
Le caquiste préfère d'ailleurs utiliser l'expression disposition de souveraineté parlementaire
à la place de disposition de dérogation
, puisque cette disposition sert à faire respecter la volonté du peuple
.
Vers un appel en Cour suprême
Fort attendu, le jugement rendu jeudi statue sur un total de huit appels. Les parties intéressées avaient été entendues en novembre 2022.
Nous sommes manifestement déçus
, a déclaré le président de la Commission scolaire English-Montréal (CSEM), Joe Ortona, au cours des minutes qui ont suivi la publication du jugement. Un appel est toujours sur la table
, a-t-il admis, faisant référence à la possibilité que la Cour suprême du Canada soit saisie du dossier.
La CSEM, cela dit, prendra le temps de lire le jugement avant de prendre une décision, a prévenu M. Ortona. Il faut se baser sur des principes de droit et non sur des émotions
, a-t-il fait valoir.
Toutefois, si la cause se rend jusqu'en Cour suprême, le fédéral se fera entendre à coup sûr, a confirmé le ministre de la Justice du Canada, Arif Virani, en point de presse.
Ce sera l'occasion pour le gouvernement Trudeau de défendre
la Charte canadienne des droits et libertés ainsi que sa vision de la « clause dérogatoire », qui devrait être un outil de dernier recours et non pas de premier recours
, a plaidé le ministre Virani.

Le ministre fédéral de la Justice, Arif Virani, a déclaré jeudi que les tenants et aboutissants du débat au sujet de la constitutionnalité de la Loi sur la laïcité de l'État du Québec en font un « enjeu national ».
Photo : La Presse canadienne / Justin Tang
Le premier ministre Justin Trudeau a également déclaré que si et quand [cette question] finira à la Cour suprême
, le gouvernement libéral va intervenir
.
À l'inverse, le Mouvement laïque québécois s'est réjoui de la décision de la Cour d'appel, jeudi. C’est une victoire sur toute la ligne pour tous ceux qui défendent la laïcité et c’est une victoire plus largement pour le Québec [...] dans sa capacité à faire ses choix
, a résumé l'avocat Guillaume Rousseau.
Selon Me Rousseau, la Cour suprême devrait refuser d'entendre l'appel puisque les arguments de la Cour d’appel sont "béton"
.
À Ottawa, trois partis politiques sont en faveur d’un renvoi en Cour suprême, soit le Parti libéral du Canada (PLC), le Parti conservateur du Canada (PCC) et le Nouveau Parti démocratique (NPD). Le Bloc québécois s’y oppose.